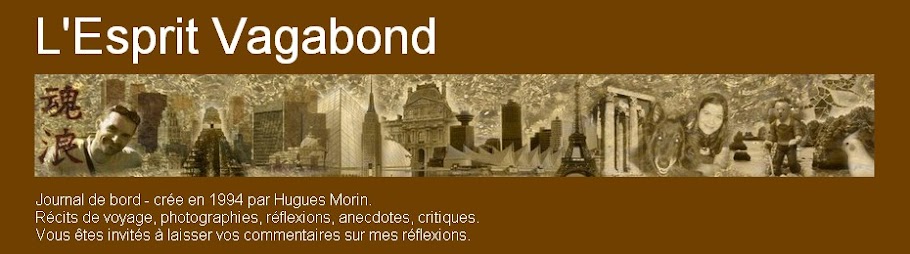Réforme fiscale: contexte.
Dans mon dernier billet, je m'opposais à l'idéologie de l'utilisateur-payeur. Cette philosophie de la tarification des services publics est en opposition avec celle de la taxation et de l'imposition. Or comme l'État doit financer ses services publics, je suis donc en faveur de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la consommation.
Je n'aborderai pas ici les questions de fraudes fiscales (en principe, on devrait combattre la fraude), mais je me pencherai sur des exemples qui montrent comment notre fiscalité au Québec est actuellement déficiente dans son rôle principal; c'est-à-dire percevoir les justes parts de chacun et s'en servir pour financer les services publics.
Injustice fiscale.
Je ne veux pas être aride, ni trop long, alors j'irai droit au coeur du sujet du jour. Les gens les plus riches de notre société ne paient pas leur juste part d'impôts. Or, des gens qui gagnent des centaines de milliers de dollars (voir des millions), il y en a, et de plus en plus. Je ne parle pas ici d'augmenter les paliers d'imposition ou le taux des impôts des riches, non, je parle seulement des diverses exemptions et crédits qui n'avantagent que les plus riches et qui existent pour une seule et unique raison: les lobbys financés par ces riches ont réussis à les faire intégrer aux complexes règles fiscales québécoises. Ces exemptions et déductions avantageuses font en sorte que plusieurs contribuables très riches paient un taux d'impôt ridiculement bas, et souvent plus bas que tous les contribuables de la classe moyenne!
Je ferai une démonstration en cinq points; chacun consacré à une exemption ou une déduction spécifique, afin d'illustrer ce que j'avance (a).
Avant de débuter, gardez en mémoire que le taux d'impôt de base des particuliers au Canada est de 15%, et qu'au Québec, ce taux de base est de 16%. Les exemples qui suivent permettent à des contribuables gagnant plus 150 000$ de profiter de taux bien en deçà de ces taux de base.
--
1. Exemption pour employé d'un Centre Financier International (CFI).
Savez-vous qu'au Québec, le salaire d'un employé de CFI est totalement ou partiellement exempté d'impôt? Si l'employé est un étranger venu s'installer chez nous pour brasser de la haute finance, son exemption est de 100% de son salaire pendant deux ans, puis ça descend à 75%, 50% puis 37,5%. Deux ans de salaire (dans les six chiffres) sans impôt. Pour les employés de ces centres nés au Québec, la déduction maximale est de 37,5%, mais descendra à 30%, 20% puis à 10%.
Posons par exemple un employé québécois qui gagne 300 000$ avec une exemption (moyenne) de 25%. Selon certaines hypothèses de base (b), ce contribuable déduira de son revenu 75 000$ exempté, puis 22 450$ (c) de REER. Il aura donc 56 165$ d'impôt fédéral, et 41 668$ d'impôt du Québec, soit des taux d'imposition respectifs de 18,7% au fédéral (soit 56 165$/300 000$ - tous mes calculs sont effectués de la sorte: taux effectif sur revenu total). Au Québec, son taux est de 13,8%. Cette année-là, ce contribuable aura conservé 67,5% de sa rémunération, soit 202 167$.
Son taux fédéral est donc équivalent à un contribuable qui gagne entre 40 000$ et 80 000$. Son taux québécois est plus bas qu'un contribuable qui gagne 40 000$.
Vous n'en revenez pas? Attendez; précisons que de plus, le CFI, qui est une compagnie, et qui paye notre ami 300 000$ a droit à un crédit d'impôt de 30% sur ce salaire, soit 90 000$ de ses revenus d'entreprise sur lequel le CFI n'a pas à payer ses impôts corporatifs.
Vous croyez que ces CFI sont rares? Fin 2009, il y en avait 114 reconnus par Revenu Québec (d).
Que font les CFI pour avoir ces avantages? Il offrent des services financiers internationaux; autrement dit, il s'agit de banques et de firmes de courtage, mais dont la spécificité est de se charger de transactions internationales (prêts, courtage de valeurs mobilières, etc).
Ils ont également un excellent lobby qui a su convaincre les ministres des finances de leur donner en cadeau cet argent public (certains mémoires, comme celui de la RBC, par exemple, sur les règles fiscales des CFI, recommandaient même l'exemption totale d'impôt sur le revenu, de taxe sur le capital et de contribution au fonds des services de santé).
--
Voici certainement une panoplie de règles fiscales spécifiques à des investissements dans des sociétés qui exploitent des ressources naturelles (minières, gazières et pétrolières) qui sont parmi les plus tarabiscotées des lois fiscales canadiennes et québécoises. En gros, le contribuable investi quelques milliers de dollars dans ces sociétés, ce qui leur permet de se financier facilement, et l'individu reçoit en échange de très généreuses déductions et crédits d'impôts.
Imaginons un professionnel qui gagne 300 000$. Il investi 100 000$ dans des sociétés exploitant des ressources naturelles montées à cet effet (e) et disons, contribue à son REER (f).
Puisque ce contribuable, qui gagne 300 000$, déduira de son revenu un montant de 96 000$ à titre de frais d'exploration, puis 22 450$ de REER (c), et qu'il profitera d'un crédit d'impôt à l'investissement, il payera un impôt fédéral de 25 705$. Au Québec, un jeu de 4 déductions (exploration, exploration au Québec, investissement stratégique et frais financiers) permettent de déduire 110 700$ du 100 000$ investi... ce qui donne à notre contribuable un impôt du Québec de 32 373$. Il profite donc de taux d'imposition respectifs de 8,5% et de 10,7%. Cette année-là, ce contribuable aura conservé 80,6% de sa rémunération, soit 241 922$.
Son taux d'impôt combiné est donc plus bas que celui d'un contribuable qui gagne 40 000$ (en fait, à peine plus de la moitié du taux combiné de ce dernier).
Pourquoi une telle mécanique existe-t-elle? À qui profite ces cadeaux fiscaux? À part l'évidence de profiter aux plus riches ayant le loisir d'investir dans ce genre de chose, la mesure profite évidemment aux minières, gazières et pétrolières, que le fisc finance ainsi indirectement et qui n'ont pas à se soucier de trouver du financement traditionnel pour leurs activités d'exploration et d'exploitation. La mesure profite évidemment aux courtiers qui touchent leurs commissions sur ces placements qui sont même appelés officiellement "abris fiscaux", ainsi qu'aux avocats qui effectuent les montages légaux de ce financement à même les fonds publics.
--
3. La déduction d'impôt sur les options d'achats d'actions.
On entend souvent parler, quand les médias nous parlent des "salaires" des hauts dirigeants d'entreprises, qu'ils sont rémunérés à partir de plusieurs outils, dont des options d'achats d'actions. Expliqué simplement, disons que si je veux donner 150 000$ de rémunération à un employé avec cet outil, et que les actions de la compagnie valent 100$ au moment de la rémunération, je lui donne des options lui permettant d'acheter 1500 actions, à un prix fixe de 100$ l'action. Au moment de donner cette option, l'employé ne sera pas imposé sur le montant de la rémunération, car tant qu'il n'a pas exercé cette option, il ne détient que l'option d'achat, et non les actions (g).
Prenons un contribuable qui gagne 300 000$, mais que son employeur rémunère avec 150 000$ de salaire et 150 000$ d'options d'achats d'actions (1500 @ 100$). Posons l'hypothèse qu'il attend un an (pendant laquelle il reçoit le même salaire de base de 150 000$), puis il exerce ses options, alors que l'action vaut maintenant 125$. Lors de cette année, il aura donc un "avantage", qu'il aura tiré de la variation de valeur des actions (ici, il achète à 100$ mais ça vaut déjà 125$; donc 37 500$ de gain immédiat s'il revend le jour même). Posons l'hypothèse qu'il contribue à son REER (h).
Ce contribuable a donc, cette année-là, 150 000$ de salaire de base, plus 37 500$ d'avantage sur ses options (s'il revend les actions à 125$ immédiatement, il encaisse en fait 337 500$ au total cette année-là).
Une déduction lui permet d'exempter d'impôt 50% de son avantage au fédéral et 25% au Québec. Il paye donc un impôt fédéral de 25 339$ et un impôt du Québec de 30 219$, soit des taux respectifs d'impôts de 8,4% et de 10,1%.
Son taux d'impôt combiné est donc plus bas que celui d'un contribuable qui gagne 40 000$ (en fait, moins de 60% du taux combiné de ce dernier).
À qui profite cette mesure? Aux hauts dirigeants de grandes entreprises. Aucune petite entreprise n'a les moyens d'instaurer cette mesure à grande échelle et de distribuer des options et des actions, et aucun employé parmi les employés de la classe moyenne ou les employés à bas salaires n'est rémunéré en actions ou en options. C'est actuellement une des meilleures manières de faire des millions de revenu annuels tout en évitant carrément de payer de l'impôt sur une grande partie de cette rémunération. Mon exemple fait état de quelques dizaines de milliers de dollars d'option, or la tendance de la "norme" de rémunération des hauts dirigeants se chiffre plutôt dans les millions, voir même les dizaines de millions, dont une grande partie est exemptée d'impôt sur le revenu. [Un exemple: En 2011, Bombardier et Bell annoncent que leur plus haut dirigeant touche 5 millions en options diverses sur leurs 8 à 9 millions de rémunération totale].
--
4. Le gain en capital imposable à 50%.
Tous les gains en capital sont imposables à 50%, tant au niveau fédéral qu'au Québec. Ceci veut dire que si vous achetez des actions (en bourse, par exemple), et que celles-ci prennent de la valeur, puis que vous les revendez, le gain réalisé sur cette "loterie boursière" n'est imposable qu'à la moitié; la moitié de vos gains sont totalement exemptés d'impôt. Ce revenu qui n'a aucun lien avec le travail, ou l'effort, mais seulement à voir avec votre capital (richesse) de départ, est exempté à 50% de tout impôt.
Prenons par exemple mon contribuable du point 3. L'année suivante, il n'exerce aucune option, mais décide de vendre les actions achetées l'année précédente grâce à ses options. Disons qu'il vend alors que les actions valent 138$. Il obtient donc 207 000 $ pour des actions payées 150 000$, donc un gain réel de 57 000$. Comme il a été imposé sur l'avantage (en partie seulement, voir point 3 ci-haut), on considère seulement son gain entre la valeur de 138$ et celle de 125$ au moment de l'exercice des options. Donc, un gain "fiscal" de 39 000$. Ce gain n'est imposable qu'à 50%, donc il inclus dans son revenu un montant de 19 500$ en plus de son 150 000$ de salaire. S'il contribue à son REER (h), il aura un impôt fédéral de 22 370$ et un impôt du Québec de 25 280$. Nous parlons ici de taux respectifs d'impôt de 10,8% et de 12,2%.
Mais attendez, et prenons un autre exemple, celui d'un contribuable comme mon employé de CFI du point 1, qui accumule ses richesses à vitesse de 240 000$ par an moins son coût de vie. Posons l'hypothèse qu'il a investi cet argent en bourse pendant quelques années, et l'année où il quitte le CFI pour un emploi "ordinaire" à disons, 100 000$ de salaire, il vend ses placements et réalise un gain sur cette vente de 200 000$. Il a donc un revenu de 300 000$ cette année-là, mais dont 50% du gain (donc 100 000$) est totalement exempté d'impôt. Son impôt fédéral sera de 32 117$ et son impôt du Québec sera de 34 940$ (i).
Ses taux d'impôts sont donc de 10,7% et de 11,6% respectivement.
Vous rappelez-vous que le taux d'impôt de base des particuliers au Canada est de 15%, et qu'au Québec, ce taux de base est de 16%?
À qui profite cette mesure d'exemption de 50% des gains en capital? Aux gens qui peuvent en réaliser, aux gens qui accumulent assez d'argent pour pouvoir le faire fructifier. Pour exempter 50 000$ de gain, il faut réaliser 100 000$ de gain total, donc avoir investi plusieurs dizaines/centaines de milliers de dollars pour réaliser ce gain; bref, il faut avoir accumulé de la richesse; être parmi les mieux nantis de la société. La mesure profite également aux banques et aux courtiers qui gagnent leurs commissions en effectuant les transactions pour ces riches clients. Le contribuable lambda qui gagne 40 000$ avant impôt n'a que peu d'argent résiduel pour investir sur les marchés financiers (surtout s'il contribue déjà à un REER).
Cette mesure profite uniquement à ceux qui ont accumulé beaucoup de richesses, beaucoup de liquidités; puisque c'est la seule manière de réaliser du gain en capital boursier important (j).
--
5. Plafond élevé de contributions au REER.
Le REER est un bon outil pour que les gens qui n'ont aucun régime de retraite puisse s'en bâtir un à leur manière. La règle fiscale permettant de déduire de ses revenus (dont d'exempter d'impôt) les contributions aux REER est là pour inciter les gens à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Il faut aussi savoir que toute somme investie dans un REER peut fructifier à l'abri de l'impôt; les revenus d'intérêts, de dividendes ou les gains en capital réalisés à même les investissements fait dans le REER sont exemptés d'impôts. Je ne critiquerai pas l'ensemble de ces mesures du point de vue incitatif.
Par contre, j'avoue ne pas saisir un des éléments; le "plafond" autorisé de contributions (appelé officiellement "Maximum déductible au titre des REER").
Ce plafond, il existe pour empêcher les gens très riches de mettre énormément d'argent dans leur REER (et ainsi ne pas payer d'impôt sur ces revenus ni sur les gains accumulés ensuite dans le REER en question). C'est donc une bonne idée d'implanter un plafond.
Le plafond dépend de deux éléments (k): une limite annuelle fixée par règlement fiscal, et une limite annuelle de 18% des revenus de l'année précédente du contribuable.
Je vous invite à relire mes 4 exemples; vous y verrez que pour chacun, j'ai utilisé le plafond de 2011 (c), qui était de 22 450$. Or comme ce plafond augmente à chaque année, le plafond de 2012 est déjà connu; il est de 22 970$.
Faites un calcul rapide et vous verrez que ceux qui peuvent réellement profiter au maximum de cette mesure et de ce plafond, en 2012, sont les gens qui feront plus de 127 611$. Le contribuable gagnant 40 000$ de salaire est limité à 7 200$ de contribution, et donc, d'exemption fiscale. Ce plafond (annuel, répétons-le), permet donc aux contribuables les plus riches d'exempter plus de revenus d'impôts et de mettre plus d'argent à l'abri de l'impôt.
--
Réforme fiscale: Une conclusion.
Vu la longueur de ce billet, je conclurai brièvement sur cette démonstration.
Tous mes exemples étaient basés sur des contribuables faisant entre 150 000$ et 300 000$ par an. Imaginez les sommes en jeu quand on parle de millions de rémunération ou de gains; imaginez les sommes dont se prive l'État - volontairement - pour favoriser cette élite.
Ce que ma démonstration indique, c'est que si l'impôt sur le revenu est une manière pour chaque contribuable de faire sa juste part dans le financement des services publics, les lacunes dans la Loi Québécoise favorisent sans cesse les plus riches, ramenant leur part à un % d'impôt que l'on ne peut que qualifier d'injuste, si on le compare au commun des mortels de la classe moyenne.
Je vous laisse juger des motivations des ministres des finances et des premiers ministres qui permettent cette injustice; surtout lorsqu'ils nous disent que l'État n'a pas d'argent, qu'il faut faire sa juste part, et que pour ce faire, on devra faire face à la tarification des services publics.
Personnellement, je trouve ridicule que l'on traite d'idéalistes, d'irréalistes ou de communistes ceux qui veulent parler de réformer la fiscalité. Vous noterez que jamais dans cette démonstration je n'ai même mentionné de hausse des taux d'impôts des particuliers, même des plus riches. Il faudrait d'abord commencer par s'assurer qu'ils paient leurs impôts sur leur revenu, et non des impôts sur un revenu "élagué" par un favoritisme fiscal totalement injuste, avant de modifier des taux qui ne sont pas effectifs actuellement.
--
Notes:
(a) J'évite ici de détailler les calculs fiscaux complexes, puisqu'ils rendraient très lourd ce billet et sa compréhension. N'hésitez pas à les soumettre à un comptable ou un fiscaliste ou à un simple logiciel d'impôt des particuliers si le coeur vous en dit. J'ai choisi cinq thèmes fiscaux; il en existe des dizaines d'autres qui auraient pu illustrer mon propos.
(b) Disons, marié, conjointe qui gagne très bien sa vie également, et deux enfants.
(c) Maximum déductible à titre de REER en 2011.
(d) Sources: Journal les Affaires.
(e) Il existe tout un marché spécialisé, soutenu par les compagnies minières, gazières et pétrolières afin de monter les structures légales qui permettent ces déductions fiscales et ce financement par des particuliers-investisseurs.
(f) Autres hypothèses, pour fins de simulation; marié, conjointe a un revenu de disons 30 000$, deux enfants.
(g) Je simplifie un peu, pour des fins évidentes de compréhension, ce billet n'étant pas un cours de fiscalité.
(h) Et disons qu'il est célibataire et sans enfants, pour varier les exemples.
(i) Contribution maximale au REER, pas de conjoint ni d'enfants.
(j) Je ne traite pas ici de l'exemption totale du gain en capital pour les petites entreprises, qui est une mesure pour stimuler l'entreprenariat local.
(k) Je simplifie en éliminant les Régime de Pension agréés du calcul, mais le raisonnement de base demeure le même.
Dans mon dernier billet, je m'opposais à l'idéologie de l'utilisateur-payeur. Cette philosophie de la tarification des services publics est en opposition avec celle de la taxation et de l'imposition. Or comme l'État doit financer ses services publics, je suis donc en faveur de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la consommation.
Je n'aborderai pas ici les questions de fraudes fiscales (en principe, on devrait combattre la fraude), mais je me pencherai sur des exemples qui montrent comment notre fiscalité au Québec est actuellement déficiente dans son rôle principal; c'est-à-dire percevoir les justes parts de chacun et s'en servir pour financer les services publics.
Injustice fiscale.
 |
| Rémunération d'un haut dirigeant de banque, tiré du site web de Radio-Canada. |
Je ferai une démonstration en cinq points; chacun consacré à une exemption ou une déduction spécifique, afin d'illustrer ce que j'avance (a).
Avant de débuter, gardez en mémoire que le taux d'impôt de base des particuliers au Canada est de 15%, et qu'au Québec, ce taux de base est de 16%. Les exemples qui suivent permettent à des contribuables gagnant plus 150 000$ de profiter de taux bien en deçà de ces taux de base.
--
 |
| Site promotionnel des CFI. Deux ans sans payer d'impôt pour certains employés. |
Savez-vous qu'au Québec, le salaire d'un employé de CFI est totalement ou partiellement exempté d'impôt? Si l'employé est un étranger venu s'installer chez nous pour brasser de la haute finance, son exemption est de 100% de son salaire pendant deux ans, puis ça descend à 75%, 50% puis 37,5%. Deux ans de salaire (dans les six chiffres) sans impôt. Pour les employés de ces centres nés au Québec, la déduction maximale est de 37,5%, mais descendra à 30%, 20% puis à 10%.
Posons par exemple un employé québécois qui gagne 300 000$ avec une exemption (moyenne) de 25%. Selon certaines hypothèses de base (b), ce contribuable déduira de son revenu 75 000$ exempté, puis 22 450$ (c) de REER. Il aura donc 56 165$ d'impôt fédéral, et 41 668$ d'impôt du Québec, soit des taux d'imposition respectifs de 18,7% au fédéral (soit 56 165$/300 000$ - tous mes calculs sont effectués de la sorte: taux effectif sur revenu total). Au Québec, son taux est de 13,8%. Cette année-là, ce contribuable aura conservé 67,5% de sa rémunération, soit 202 167$.
 |
| Quelques-uns des CFI en activité à Montréal. |
Vous n'en revenez pas? Attendez; précisons que de plus, le CFI, qui est une compagnie, et qui paye notre ami 300 000$ a droit à un crédit d'impôt de 30% sur ce salaire, soit 90 000$ de ses revenus d'entreprise sur lequel le CFI n'a pas à payer ses impôts corporatifs.
Vous croyez que ces CFI sont rares? Fin 2009, il y en avait 114 reconnus par Revenu Québec (d).
Que font les CFI pour avoir ces avantages? Il offrent des services financiers internationaux; autrement dit, il s'agit de banques et de firmes de courtage, mais dont la spécificité est de se charger de transactions internationales (prêts, courtage de valeurs mobilières, etc).
Ils ont également un excellent lobby qui a su convaincre les ministres des finances de leur donner en cadeau cet argent public (certains mémoires, comme celui de la RBC, par exemple, sur les règles fiscales des CFI, recommandaient même l'exemption totale d'impôt sur le revenu, de taxe sur le capital et de contribution au fonds des services de santé).
--
Voici certainement une panoplie de règles fiscales spécifiques à des investissements dans des sociétés qui exploitent des ressources naturelles (minières, gazières et pétrolières) qui sont parmi les plus tarabiscotées des lois fiscales canadiennes et québécoises. En gros, le contribuable investi quelques milliers de dollars dans ces sociétés, ce qui leur permet de se financier facilement, et l'individu reçoit en échange de très généreuses déductions et crédits d'impôts.
Imaginons un professionnel qui gagne 300 000$. Il investi 100 000$ dans des sociétés exploitant des ressources naturelles montées à cet effet (e) et disons, contribue à son REER (f).
Puisque ce contribuable, qui gagne 300 000$, déduira de son revenu un montant de 96 000$ à titre de frais d'exploration, puis 22 450$ de REER (c), et qu'il profitera d'un crédit d'impôt à l'investissement, il payera un impôt fédéral de 25 705$. Au Québec, un jeu de 4 déductions (exploration, exploration au Québec, investissement stratégique et frais financiers) permettent de déduire 110 700$ du 100 000$ investi... ce qui donne à notre contribuable un impôt du Québec de 32 373$. Il profite donc de taux d'imposition respectifs de 8,5% et de 10,7%. Cette année-là, ce contribuable aura conservé 80,6% de sa rémunération, soit 241 922$.
Son taux d'impôt combiné est donc plus bas que celui d'un contribuable qui gagne 40 000$ (en fait, à peine plus de la moitié du taux combiné de ce dernier).
Pourquoi une telle mécanique existe-t-elle? À qui profite ces cadeaux fiscaux? À part l'évidence de profiter aux plus riches ayant le loisir d'investir dans ce genre de chose, la mesure profite évidemment aux minières, gazières et pétrolières, que le fisc finance ainsi indirectement et qui n'ont pas à se soucier de trouver du financement traditionnel pour leurs activités d'exploration et d'exploitation. La mesure profite évidemment aux courtiers qui touchent leurs commissions sur ces placements qui sont même appelés officiellement "abris fiscaux", ainsi qu'aux avocats qui effectuent les montages légaux de ce financement à même les fonds publics.
--
 |
| Tiré d'un article de la Presse Canadienne, sur la valeur des options et actions reçues par le Président de Bell. |
On entend souvent parler, quand les médias nous parlent des "salaires" des hauts dirigeants d'entreprises, qu'ils sont rémunérés à partir de plusieurs outils, dont des options d'achats d'actions. Expliqué simplement, disons que si je veux donner 150 000$ de rémunération à un employé avec cet outil, et que les actions de la compagnie valent 100$ au moment de la rémunération, je lui donne des options lui permettant d'acheter 1500 actions, à un prix fixe de 100$ l'action. Au moment de donner cette option, l'employé ne sera pas imposé sur le montant de la rémunération, car tant qu'il n'a pas exercé cette option, il ne détient que l'option d'achat, et non les actions (g).
Prenons un contribuable qui gagne 300 000$, mais que son employeur rémunère avec 150 000$ de salaire et 150 000$ d'options d'achats d'actions (1500 @ 100$). Posons l'hypothèse qu'il attend un an (pendant laquelle il reçoit le même salaire de base de 150 000$), puis il exerce ses options, alors que l'action vaut maintenant 125$. Lors de cette année, il aura donc un "avantage", qu'il aura tiré de la variation de valeur des actions (ici, il achète à 100$ mais ça vaut déjà 125$; donc 37 500$ de gain immédiat s'il revend le jour même). Posons l'hypothèse qu'il contribue à son REER (h).
Ce contribuable a donc, cette année-là, 150 000$ de salaire de base, plus 37 500$ d'avantage sur ses options (s'il revend les actions à 125$ immédiatement, il encaisse en fait 337 500$ au total cette année-là).
Une déduction lui permet d'exempter d'impôt 50% de son avantage au fédéral et 25% au Québec. Il paye donc un impôt fédéral de 25 339$ et un impôt du Québec de 30 219$, soit des taux respectifs d'impôts de 8,4% et de 10,1%.
 |
| Tiré d'un article de la Presse Canadienne: Rémunération à base d'actions et d'options du président de Bombardier. |
À qui profite cette mesure? Aux hauts dirigeants de grandes entreprises. Aucune petite entreprise n'a les moyens d'instaurer cette mesure à grande échelle et de distribuer des options et des actions, et aucun employé parmi les employés de la classe moyenne ou les employés à bas salaires n'est rémunéré en actions ou en options. C'est actuellement une des meilleures manières de faire des millions de revenu annuels tout en évitant carrément de payer de l'impôt sur une grande partie de cette rémunération. Mon exemple fait état de quelques dizaines de milliers de dollars d'option, or la tendance de la "norme" de rémunération des hauts dirigeants se chiffre plutôt dans les millions, voir même les dizaines de millions, dont une grande partie est exemptée d'impôt sur le revenu. [Un exemple: En 2011, Bombardier et Bell annoncent que leur plus haut dirigeant touche 5 millions en options diverses sur leurs 8 à 9 millions de rémunération totale].
--
4. Le gain en capital imposable à 50%.
Tous les gains en capital sont imposables à 50%, tant au niveau fédéral qu'au Québec. Ceci veut dire que si vous achetez des actions (en bourse, par exemple), et que celles-ci prennent de la valeur, puis que vous les revendez, le gain réalisé sur cette "loterie boursière" n'est imposable qu'à la moitié; la moitié de vos gains sont totalement exemptés d'impôt. Ce revenu qui n'a aucun lien avec le travail, ou l'effort, mais seulement à voir avec votre capital (richesse) de départ, est exempté à 50% de tout impôt.
Prenons par exemple mon contribuable du point 3. L'année suivante, il n'exerce aucune option, mais décide de vendre les actions achetées l'année précédente grâce à ses options. Disons qu'il vend alors que les actions valent 138$. Il obtient donc 207 000 $ pour des actions payées 150 000$, donc un gain réel de 57 000$. Comme il a été imposé sur l'avantage (en partie seulement, voir point 3 ci-haut), on considère seulement son gain entre la valeur de 138$ et celle de 125$ au moment de l'exercice des options. Donc, un gain "fiscal" de 39 000$. Ce gain n'est imposable qu'à 50%, donc il inclus dans son revenu un montant de 19 500$ en plus de son 150 000$ de salaire. S'il contribue à son REER (h), il aura un impôt fédéral de 22 370$ et un impôt du Québec de 25 280$. Nous parlons ici de taux respectifs d'impôt de 10,8% et de 12,2%.
Mais attendez, et prenons un autre exemple, celui d'un contribuable comme mon employé de CFI du point 1, qui accumule ses richesses à vitesse de 240 000$ par an moins son coût de vie. Posons l'hypothèse qu'il a investi cet argent en bourse pendant quelques années, et l'année où il quitte le CFI pour un emploi "ordinaire" à disons, 100 000$ de salaire, il vend ses placements et réalise un gain sur cette vente de 200 000$. Il a donc un revenu de 300 000$ cette année-là, mais dont 50% du gain (donc 100 000$) est totalement exempté d'impôt. Son impôt fédéral sera de 32 117$ et son impôt du Québec sera de 34 940$ (i).
Ses taux d'impôts sont donc de 10,7% et de 11,6% respectivement.
Vous rappelez-vous que le taux d'impôt de base des particuliers au Canada est de 15%, et qu'au Québec, ce taux de base est de 16%?
À qui profite cette mesure d'exemption de 50% des gains en capital? Aux gens qui peuvent en réaliser, aux gens qui accumulent assez d'argent pour pouvoir le faire fructifier. Pour exempter 50 000$ de gain, il faut réaliser 100 000$ de gain total, donc avoir investi plusieurs dizaines/centaines de milliers de dollars pour réaliser ce gain; bref, il faut avoir accumulé de la richesse; être parmi les mieux nantis de la société. La mesure profite également aux banques et aux courtiers qui gagnent leurs commissions en effectuant les transactions pour ces riches clients. Le contribuable lambda qui gagne 40 000$ avant impôt n'a que peu d'argent résiduel pour investir sur les marchés financiers (surtout s'il contribue déjà à un REER).
Cette mesure profite uniquement à ceux qui ont accumulé beaucoup de richesses, beaucoup de liquidités; puisque c'est la seule manière de réaliser du gain en capital boursier important (j).
--
5. Plafond élevé de contributions au REER.
Le REER est un bon outil pour que les gens qui n'ont aucun régime de retraite puisse s'en bâtir un à leur manière. La règle fiscale permettant de déduire de ses revenus (dont d'exempter d'impôt) les contributions aux REER est là pour inciter les gens à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Il faut aussi savoir que toute somme investie dans un REER peut fructifier à l'abri de l'impôt; les revenus d'intérêts, de dividendes ou les gains en capital réalisés à même les investissements fait dans le REER sont exemptés d'impôts. Je ne critiquerai pas l'ensemble de ces mesures du point de vue incitatif.
Par contre, j'avoue ne pas saisir un des éléments; le "plafond" autorisé de contributions (appelé officiellement "Maximum déductible au titre des REER").
Ce plafond, il existe pour empêcher les gens très riches de mettre énormément d'argent dans leur REER (et ainsi ne pas payer d'impôt sur ces revenus ni sur les gains accumulés ensuite dans le REER en question). C'est donc une bonne idée d'implanter un plafond.
Le plafond dépend de deux éléments (k): une limite annuelle fixée par règlement fiscal, et une limite annuelle de 18% des revenus de l'année précédente du contribuable.
Je vous invite à relire mes 4 exemples; vous y verrez que pour chacun, j'ai utilisé le plafond de 2011 (c), qui était de 22 450$. Or comme ce plafond augmente à chaque année, le plafond de 2012 est déjà connu; il est de 22 970$.
Faites un calcul rapide et vous verrez que ceux qui peuvent réellement profiter au maximum de cette mesure et de ce plafond, en 2012, sont les gens qui feront plus de 127 611$. Le contribuable gagnant 40 000$ de salaire est limité à 7 200$ de contribution, et donc, d'exemption fiscale. Ce plafond (annuel, répétons-le), permet donc aux contribuables les plus riches d'exempter plus de revenus d'impôts et de mettre plus d'argent à l'abri de l'impôt.
--
Réforme fiscale: Une conclusion.
Vu la longueur de ce billet, je conclurai brièvement sur cette démonstration.
Tous mes exemples étaient basés sur des contribuables faisant entre 150 000$ et 300 000$ par an. Imaginez les sommes en jeu quand on parle de millions de rémunération ou de gains; imaginez les sommes dont se prive l'État - volontairement - pour favoriser cette élite.
Ce que ma démonstration indique, c'est que si l'impôt sur le revenu est une manière pour chaque contribuable de faire sa juste part dans le financement des services publics, les lacunes dans la Loi Québécoise favorisent sans cesse les plus riches, ramenant leur part à un % d'impôt que l'on ne peut que qualifier d'injuste, si on le compare au commun des mortels de la classe moyenne.
Je vous laisse juger des motivations des ministres des finances et des premiers ministres qui permettent cette injustice; surtout lorsqu'ils nous disent que l'État n'a pas d'argent, qu'il faut faire sa juste part, et que pour ce faire, on devra faire face à la tarification des services publics.
Personnellement, je trouve ridicule que l'on traite d'idéalistes, d'irréalistes ou de communistes ceux qui veulent parler de réformer la fiscalité. Vous noterez que jamais dans cette démonstration je n'ai même mentionné de hausse des taux d'impôts des particuliers, même des plus riches. Il faudrait d'abord commencer par s'assurer qu'ils paient leurs impôts sur leur revenu, et non des impôts sur un revenu "élagué" par un favoritisme fiscal totalement injuste, avant de modifier des taux qui ne sont pas effectifs actuellement.
--
Notes:
(a) J'évite ici de détailler les calculs fiscaux complexes, puisqu'ils rendraient très lourd ce billet et sa compréhension. N'hésitez pas à les soumettre à un comptable ou un fiscaliste ou à un simple logiciel d'impôt des particuliers si le coeur vous en dit. J'ai choisi cinq thèmes fiscaux; il en existe des dizaines d'autres qui auraient pu illustrer mon propos.
(b) Disons, marié, conjointe qui gagne très bien sa vie également, et deux enfants.
(c) Maximum déductible à titre de REER en 2011.
(d) Sources: Journal les Affaires.
(e) Il existe tout un marché spécialisé, soutenu par les compagnies minières, gazières et pétrolières afin de monter les structures légales qui permettent ces déductions fiscales et ce financement par des particuliers-investisseurs.
(f) Autres hypothèses, pour fins de simulation; marié, conjointe a un revenu de disons 30 000$, deux enfants.
(g) Je simplifie un peu, pour des fins évidentes de compréhension, ce billet n'étant pas un cours de fiscalité.
(h) Et disons qu'il est célibataire et sans enfants, pour varier les exemples.
(i) Contribution maximale au REER, pas de conjoint ni d'enfants.
(j) Je ne traite pas ici de l'exemption totale du gain en capital pour les petites entreprises, qui est une mesure pour stimuler l'entreprenariat local.
(k) Je simplifie en éliminant les Régime de Pension agréés du calcul, mais le raisonnement de base demeure le même.