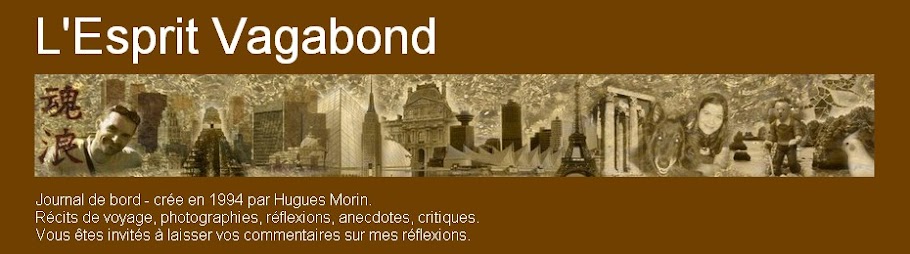Dans l'actualité locale québécoise et canadienne cette semaine, on retrouve la question de l'implication du pays dans la réaction aux actions de l'EI au Moyen-Orient. Personnellement, mon réflexe est de tenter de comprendre suffisamment la situation pour me faire une opinion quand à la participation du Québec et du Canada à la réaction internationale (1).
--
Mon intérêt pour le conflit EI/Irak/Kurdes/Syrie découle de deux origines.
La première, c'est que je voyage, et qu'en le faisant en indépendant, je ne retrouve pas dans des enclaves touristiques bien léchées et externes aux villes ou populations locales. Ainsi, règle générale, je me retrouve dans le vrai monde, même si dans ce vrai monde, je visite souvent des lieux ou sites historiques ou d'intérêt touristique. C'est comme ça que j'ai souvent été - sans même le rechercher - témoin de manifestations, d'affrontements légers, ou de mouvements citoyens lors de mes voyages.
Ces voyages ont un autre effet - à part me faire voir le reste du monde tel qu'il est lorsque j'y mets les pieds - ils rapetissent ma planète. Quand on parle d'événements qui touchent directement un pays où je suis allé, la nouvelle m'interpèle personnellement, et pas qu'à un niveau humaniste ou politiquement intéressé, mais à un niveau vraiment personnel, puisque ces lieux font désormais partie de moi, de ma vie, des éléments qui font qui je suis.
La seconde origine vient de centaines de textes de sciences politiques que j'ai eu l'occasion (et le privilège) de lire dans les cinq dernières années, par l'accès aux revues scientifiques sur le sujet dont j'ai pu profiter via les études de ma conjointe. Pour un lecteur intéressé, avoir accès à des milliers de publications donne le vertige, mais procure aussi des lectures approfondies et de qualité supérieure à l'information qui nous est généralement accessible au quotidien.
--
Je n'ai jamais mis les pieds en Irak, ni en Syrie, ni même dans la région que l'on pourrait appeler le Kurdistan (pour peu que l'on en reconnaisse l'existence qui chevauche quatre pays). Pourtant, j'ai récemment fait un court séjour en Turquie, où j'ai entre autres exploré le sud-ouest, à gauche sur la carte suivante: (Izmir, Soke, Bodrum et l'île grecque de Kos apparaissent sur la carte). Mon ami et compagnon de voyage Istvan s'est rendu jusqu'à Konya avant que je le rejoigne à Selçuk.
Les combats actuels les plus intenses se déroulent à Kobané (point rouge sur la carte), à la frontière entre la Syrie et la Turquie.
Je me sens donc interpelé par cette proximité à ma planète personnelle (l'univers que j'ai visité), mais aussi par la complexité des enjeux et acteurs du conflit, qui dépassent tout ce que les médias arrivent à nous transmettre. Je ne jette pas la pierre aux médias (et encore moins aux journalistes), c'est leur modèle d'information qui est en cause; il est absolument impossible d'expliquer ce conflit en topos de deux minutes ou en articles de 500 mots.
Si on se limite en plus aux informations en français (ou une seule langue, peu importe laquelle), les dossiers approfondis deviennent plus difficiles à dénicher.
Il est pourtant clair que le laisser-faire international dans la crise/rébellion syrienne a permis l'avènement de cette situation (et sa perte de contrôle), comme l'a fait l'intervention stupide (et ratée) des américains en Irak en 2003 et l'abandon du pays à son sort par la suite. Il semble aussi évident que la situation conflictuelle des kurdes en Turquie ait été sous-estimée et c'est peut-être cette situation qui permet le mieux d'illustrer, comme un microcosme du conflit global, la complexité de ce dernier.
Doit-on aider son ennemi - et même l'armer - pour combattre un pire ennemi commun au risque que notre ennemi se serve ensuite de ces armes contre nous? (2)
Question intéressante et représentative de la complexité de ce conflit.
En effet, le gouvernement turc se retrouve avec un dilemme difficile (voire impossible) à résoudre: Si elle aide à combattre l'EI (la Turquie condamne évidemment les actions de l'EI), elle renforce la position de son "ennemi intérieur" (qui combat la Turquie pour les droits des kurdes de ce pays et prône la création d'un état indépendant kurde). Et on ne parle pas ici de simple débat d'idées, ici, mais bien de combats, de mouvements d'armes, d'implication militaire (ne serait-ce que pour offrir un corridor humanitaire sécurisé).
Je n'ai évidemment pas la prétention de vouloir expliquer cette complexité ici, mais j'ai pour ambition de comprendre suffisamment la situation pour me faire une opinion quand à la participation du Canada à la réaction internationale.
--
Si jamais la chose vous intéresse aussi, si vous aimeriez mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi il est délicat et difficile de décider si on doit intervenir (et qui doit le faire, et comment), je vous suggère quelques pistes de lecture ici bas. Certains passages aident également à comprendre la responsabilité historique des pays de l'occident dans la situation, qui remonte au partage des restes de l'empire ottoman parmi les puissances coloniales à la fin de la première guerre mondiale.
Et comme on nous parle surtout de terroristes (3) quand on aborde la question des conflits aux Proche-Orient et au Moyen-Orient, il est toujours pertinent de rappeler que les héros des uns sont les terroristes des autres (et vice-versa) alors que la question est nécessairement plus complexe que ça; les échecs des interventions américaines dans leur guerre au terrorisme sont là pour nous le rappeler. L'actuelle situation en Irak vient douloureusement hanter nos voisins amateurs de solutions armées, au moment où ils frappent à notre porte pour les aider et les soutenir. Est-ce une bonne idée de le faire, et de la manière choisie par le gouvernement canadien?
--
Notes:
(1) Actuellement, l'engagement du Canada découle d'une
motion approuvée par le parlement canadien (majorité du gouvernement Harper qui a aussi imposé le bâillon) le 7 octobre dernier selon laquelle le pays s'engage dans des frappes aériennes (jusqu'à six mois) sans qu'il ne soit question de participer à des opérations terrestres. On apprend par contre que le mandat est plus large et comprend la fourniture d'armes à "des alliés dans le nord de l'Irak" (
source: Radio-Canada ).
L'opposition officielle s'est prononcé contre ce plan d'action du gouvernement Harper, que le NPD qualifie d'improvisé et mal défini. L'opposition propose plutôt une réponse humanitaire (
source: NPD).
La seconde opposition à Ottawa n'a pas non plus appuyé l'initiative du gouvernement Harper, mais ses propos sont ambigus, et le député Marc Garneau a déclaré qu'une fois la mission débutée, son parti appuierait les soldats canadiens (sources:
PLC et deux
articles du journal
Le Devoir.
--
(2) La question se pose pour la Turquie en ce moment, mais la même question s'applique à plusieurs des interventions américaines au Moyen-Orient (voir la guerre Iran-Irak, par exemple).
--
(3) Gérard Chaliand rappelle d'ailleurs que
«Les succès du terrorisme, à proprement parler, en Occident au cours des années qui ont suivi les attentats du 11 Septembre sont quoi qu’on dise très limités. On est loin des perspectives apocalyptiques annoncées par Oussama Ben Laden il y a une douzaine d’années. Nuisance coûteuse, le terrorisme international reste un phénomène surtout psychologique dont les médias garantissent le retentissement démesuré par rapport à ses effets physiques» (dans "Les jeux de l’échiquier au Proche et Moyen-Orient", NAQD, 2014, 31, p.83-93).
--
Références - Médias traditionnels:
Trois articles sur la situation de la Turquie:
La Turquie veut-elle vraiment la paix avec les Kurdes? (France24)
Turquie : "Les Kurdes risquent de se retourner contre nous" (France24)
Pourquoi la Turquie ne vient-elle pas au secours des Kurdes? (Le Devoir)
Syrie:
Même si elle date de 2012,
cette carte de l'opposition syrienne (et le court texte qui se retrouve au bas de la page) est intéressante et permet de saisir un peu mieux l'origine et la complexité de cette opposition au régime (Radio-Canada).
Le Kurdistan:
Une page Wikipédia qui résume assez bien l'histoire contemporaine de la région, en plus de détailler les grandes lignes du
nationalisme kurde par pays. Ceci permet entre autres de saisir l'origine des kurdes syriens et leurs liens avec les kurdes turcs, en plus de comprendre que l'opposition entres kurdes de Turquie et le gouvernement turc remonte à la création même de la Turquie.
Références - Revues scientifiques:
Nationalisme kurde:
Les paradoxes du printemps kurde en Syrie, dans Politique Étrangère (2014/2, été, p.51-61)
Les Kurdes et l’option étatique, dans Politique Étrangère (2014/2, été, p.15-26)
Syrie:
La reconfiguration des espaces transfrontaliers dans le conflit syrien, Analyse Noria, février 2014 -
disponible en ligne.
Le «cavalier seul» des Kurdes de Syrie, sur Orient XXI (un média intermédiaire entre journalisme et articles académiques) - mars 2014, article
disponible en ligne.
La question kurde et la guerre civile syrienne (sur un carnet d'accompagnement de la recherche "Le Proche-Orient et la crise syrienne - paradigmes en débat") -
disponible en ligne.
--